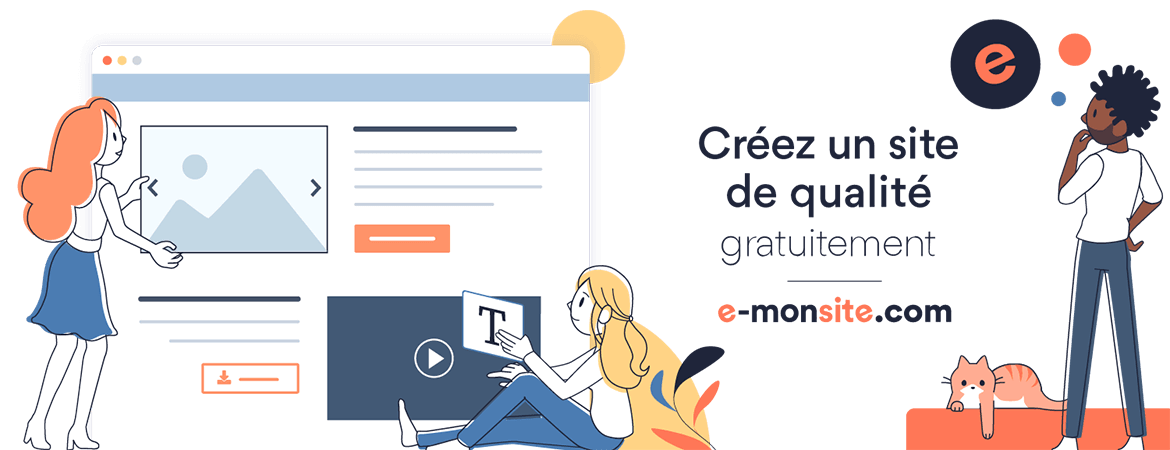Les Prix ARDUA 2016
Grand Prix 2016 décerné à ERRI de LUCA dans les salons de la Mairie de Bordeaux....
_______________________________________________________________________________________________________________________
Erri de Luca, c’est un grand honneur pour l’ARDUA de vous accueillir aujourd’hui, dans ces salons de la Mairie de Bordeaux, pour vous remettre notre Grand Prix 2016. Un grand honneur et une joie sincère tellement nous admirons vos livres qui ont la rareté des vraies épures, où la parole est comme distillée.
Ces livres, ils sont beaux et ils sont utiles. Utiles, dans le sens où nous en avons besoin. Dans notre monde dur, violent, et injuste (car ils font partie de notre monde, ces monstres froids qui, toujours plus avides de pouvoir et d’argent, condamnent des millions de gens à la misère, à la révolte, à la fuite, à la mort, car ils font partie de notre monde ces fanatiques qui enlèvent, vendent, lapident, égorgent, décapitent font exploser tant de merveilles artistiques et tant de corps fragiles), dans notre monde violent et injuste, votre voix simple et musicale arrive à subsister et même à se faire entendre. C’est pour cela que l’ARDUA espérait tant vous remettre son grand Prix 2016, car « l’obscurité n’imprègne pas votre écriture qui dit la beauté de la nature et de l’art, la noblesse de la pensée et la lutte contre les puissances qui menacent l’humain et la nature.
Si vos lecteurs ressentent aussi unanimement cette sorte d’ascèse, s’ils sont autant touchés par votre « simplicité », c’est aussi parce vous avez un sens de la poésie qui semble naturel, tant votre écriture nous fait oublier la rhétorique. Tout se tient chez vous. Ce sens de la poésie ne serait pas là, s’il n’était porté par un regard unique : regard d’enfant (l’enfant que vous avez su conserver en vous) mais aussi regard des humbles, de ces « minuscules » dont parle Michon, de « ces muets », « les sans voix » que vous évoquez dans La parole contraire. A travers ce double regard de l’enfant et des humbles, tout est ramené chez vous à sa vérité dépouillée. Il y a dans votre œuvre la lutte contre les forces qui menacent l’humain mais il y a aussi l’élan de l’homme vers le spirituel, comme on peut le pressentir parmi bien d’autres textes (Sur la trace de Nives, Noyau d’Olive) dans ce très beau récit initiatique Montedidio. Le narrateur, quand il entre dans la vie, est en tension permanente vers les cieux, mais il reste cloué au sol. C’est ce que vous représentez magnifiquement avec le boomerang qu’il tente de projeter dans les airs, et qui reste dans ses mains.
Ce dépouillement exceptionnel de votre écriture doit être rapproché de votre parcours exceptionnel. Vous êtes entré assez tard en littérature. Sans exagération aucune, votre parcours est exceptionnel. Il est fondé à la fois sur la liberté, une riche expérience, et le souci constant de dépassement de soi. Rien, sinon un idéal de justice sociale, ne vous prédisposait à vous engager intensément dans le combat politique d’extrême gauche. Votre père vous destinait à une brillante carrière de diplomate. Mais à l’adolescence, vous rompez les amarres, quittez le lycée et vous engagez, militez avec ferveur pour les déshérités, le tiers-monde. Vous devenez ouvrier, au plus bas de l’échelle et faites ainsi un long séjour en France où vous travaillez dans les sous-sols. Vous irez en Afrique avec les ONG, en Bosnie au moment de la guerre où vous serez conducteur de camions. Puis vous êtes revenu en banlieue de Rome et avez mené une vie de maçon, de tailleur de pierres (que vous évoquez dans un de vos textes). Votre expérience est très riche et vous avez accordé vos paroles et vos actes. Votre engagement pour le val de Suse « contre le désastre environnemental » le prouve bien. La « parole contraire est pour vous un devoir avant d’être un droit ».
Vous avez vécu votre enfance et votre adolescence en milieu populaire, mais dans une famille bourgeoise qui avait eu des revers de fortune. Adulte, vous avez vécu entre l'Italie et la France. Ouvrier, et c’est peut-être ce qu’il y a de plus exceptionnel encore dans cette expérience, vous avez su vous ménager, dans des conditions très dures dont se souvient votre ami Antonio Prete, une vie intellectuelle. C'est de cette époque que date votre passion pour la Bible et l'hébreu - alors que vous n’êtes pas croyant. Pendant toute votre vie d'ouvrier qui durera dix-huit ans, vous vous levez très tôt, à cinq heures chaque matin, et vous vous plongez dans le dictionnaire et la grammaire d'hébreu pour traduire un morceau des Écritures et vous l'approprier. Cette lecture matinale, m’a confié Antonio Prete, vous donnait l'énergie pour affronter une journée de travail qui vous vidait pourtant de vos forces. C'est ainsi sans doute qu’est née une œuvre double de fiction romanesque et de réflexion sur l'Ancien et le Nouveau Testament. La recherche constante sur le texte biblique que vous connaissez remarquablement est aujourd’hui un des pôles majeurs de votre création.
Ecrivain napolitain, viscéralement napolitain, dans une Italie tardivement et mal unifiée, où tous les écrivains appartiennent d'abord à une région, celle de Naples étant peut-être la moins "italienne" à cause de l'influence espagnole, vous vous êtes fixé pour objectif d'écrire l'italien le plus pur, sans renoncer à user toutefois du dialecte. Ecrivain napolitain certainement mais aussitôt presque écrivain universel car humaniste. Naples est une province poétique qui tend déjà dès Montedidio vers l’universel et vos deux romans initiatiques si attachants nous plongent dans une méditation plus large sur l’être, dans le monde et dans le temps. La terre de l’Italie du Sud possède quelque chose d’essentiel et d’éternel que vous savez représenter comme une épure.
C’est peut-être parce que votre œuvre réalise si facilement la synthèse du particulier et de l’universel, qu’elle semble trouver si directement, comme immédiatement, cette dimension poétique qui nous touche tant. Il faut ajouter que votre œuvre abolit les frontières génériques sans artifice, je veux dire sans qu’il y ait de votre part un parti pris théorique d’innover à tout prix. Un parti pris théorique de ce type suppose parfois un certain terrorisme intellectuel. Je n’ai pas l’impression du tout que vous vous préoccupez de savoir si votre œuvre est d’avant-garde ou si elle relève ou non de la post-modernité, ni que ces questions vous intéressent. La réponse à cette indifférence théorique, je l’ai déjà donnée, en soulignant votre goût de la liberté. Une deuxième raison aussi puissante : j’ai l’impression que votre œuvre relève à la fois d’une nécessité intérieure et d’une exigence d’écriture. Quand elle arrive à maturité lorsque vous écrivez Une fois un jour - vous avez presque quarante ans-, elle est d’emblée poétique, à mi-chemin du récit, de l’autobiographie, inclassable. Une voix nouvelle dans notre littérature contemporaine, fraternelle, se fait entendre, une pensée poétique s’exprime qui peut saisir d’emblée cet emmêlement originel qu’il y a dans tout phénomène humain profond, car le poète se refuse à découper, segmenter ce qui peut être pressenti dans sa totalité.
Comment dire aussi ce qui n’est jamais expliqué, mais que l’on ressent dans tous vos textes, cette recherche d’une spiritualité indéfinissable, ce sentiment du sacré qu’éprouve celui qui n’a pas la foi mais n’est pas athée non plus, car il sait que la langue poétique fabrique de la transcendance. Une telle œuvre renvoie pour nous à une forme de grâce bien mystérieuse qu’un commentaire de texte ne peut pas expliquer sans l’abîmer. Je ne peux que livrer dans ce discours des impressions. Impression de grâce, oui, impression aussi d’un don. Si votre oeuvre ne peut se réduire à de l’esthétique de grande qualité, c’est parce qu’elle est engagée au sens le plus noble du terme, c’est parce que vos textes sont des dons. C’est comme si vous aviez trouvé quelque chose d’essentiel (dans la bible, dans la montagne, dans votre expérience exceptionnelle) que vous voulez transmettre ou faire circuler par la voie de la poésie et de la sensibilité. On a l’impression que ces livres sont des dons, des œuvres de transmission parce que vous avez vous-même reçu, continuez à recevoir et voulez transmettre. Le don se situe dans le domaine des valeurs spirituelles. Au fond, on pourrait caractériser cette œuvre et ce parcours exceptionnel autour d’un élément central qui semble coordonner chez vous cette diversité et cette richesse de l’expérience, votre goût de ce qui élève, comme l'alpinisme, votre autre passion, qui exige qu'on soit seul face à la montagne et à ses propres choix.
Je ne vais pas énumérer et encore moins résumer vos écrits nombreux. J’en choisirai juste trois bien différents pour donner une idée de votre création à ceux peut-être qui aujourd’hui ne vous ont pas encore lu.
Votre premier livre, autobiographique, Une fois un jour : Dans ce livre, le narrateur se souvient de ses années d'enfance dans un petit appartement situé dans une ruelle obscure de Naples dans lequel il devait jouer sans faire de bruit et obéir à l'injonction maternelle : pas ici, pas maintenant. Le narrateur interroge le mystère de cet enfant rêveur et taciturne qu'il était, sensible aux reproches de sa mère, il interroge le mystère de cette mère si proche et si lointaine et leur incompréhension mutuelle. Dans ce récit poétique et poignant, le narrateur évoque les figures aimées, l'ami d'enfance qui s'est noyé, l'épouse disparue, la servante au grand cœur de ses parents : ce livre est en fait écrit comme une lettre à la mère, à un moment où le narrateur pense qu’il va mourir. Sa mère ne le sait pas, mais lui se voit aux portes de la mort, et il lui ouvre son cœur. Le prétexte de l’ouvrage est la redécouverte d’une vieille photo, prise par le père, où la mère encore jeune, regarde un autocar, regarde à travers la vitre d’un autocar où un homme va mourir. Elle ne le sait pas, mais cet homme, c’est lui, son fils. La vitre, symbole de la séparation, qui crée une illusion de proximité par sa transparence, est une souffrance récurrente. S’il n’y avait la vitre, il y aurait le contact, la fusion. La vitre, comme les mots, crée une séparation. Plus tard, dans votre livre Au nom de la mère, vous traduirez ce besoin fusionnel en faisant dire à Marie, au moment de la naissance de Jésus : « il n’est qu’à moi ; cette nuit son nom n’est qu’à moi, qu’à moi, il n’est qu’à moi ». Vous auriez écrit ce premier texte sans l'intention de le publier, et la maladie de votre père vous aurait décidé à envoyer votre manuscrit à un éditeur. Au moment où votre père, va devenir aveugle, le jugement du père n’est peut-être plus aussi paralysant…
Le tort du soldat, un de vos derniers récits, bref. Cette brièveté est une constante. Il y a pour vous comme une nécessité toujours de passer par un récit court, c’est-à-dire une narration sans rien qui pèse ou qui pose, une narration qui va à l’essentiel. Vous parvenez encore dans ce récit qui n’est pas autobiographique à retrouver un peu la vie de votre enfance. Vous y faites surtout le lien avec les obsessions profondes de votre imaginaire : Le paradis d’Ischia – la destruction de la langue Yiddish – la shoah – le pardon impossible… et tout cela en moins de 100 pages. De manière plutôt originale, deux énonciateurs se succèdent, le traducteur qui vous ressemble et la fille de l’ancien nazi. Le traducteur a un goût prononcé pour l’escalade dans les Dolomites tandis que la fille du criminel de guerre se souvient de ses vacances sur l’île d’Ischia comme véritablement des verts paradis de l’enfance. C’est un peu comme si votre âme s’était ici dédoublée sauf que dans le roman ces deux éléments disjoints de l’identité bicéphale resteront disjoints. Il s’agit d’un roman ancré sur le traumatisme du génocide perpétré par les nazis contre les Juifs puisqu’il est question d’un criminel de guerre non jugé qui s’invente une deuxième identité pour échapper à la traque d’une justice intemporelle. On doit au premier narrateur qui est justement traducteur de littérature yiddish, des pages qui soulignent la volonté du régime nazi de réduire à néant une langue et un peuple. Le premier énonciateur se situe ainsi dans une démarche inversée par rapport au personnage central du récit, et second énonciateur, la fille du criminel de guerre. Ce dernier s’est pris de passion pour les textes de la Kabbale juive espérant y trouver la réponse à la défaite de l’ordre nazi. Ce parallèle inversé est très original et émouvant, car le traducteur est lui, en quête des signes d’une présence et d’une survie de l’âme juive et de la langue Yiddish. Pour lui, le sens de sa vie est en somme de protéger la lettre qui contient le sens de l’arbre de vie.
Au nom de la mère (2009) enfin. Vous êtes un lecteur quotidien de la Bible et pour vous le bonheur parfait est d'« être face à un vers de la Bible et, tout à coup, le comprendre dans sa simplicité ». Noyau d'olive se termine par cette phrase: « Tant que, chaque jour, je peux rester, ne fût-ce que sur une seule ligne de ces Écritures, j'arrive à ne pas me défaire de la surprise d'être vivant ». Dans le récit Au nom de la mère, d’un dépouillement extrême, vous vous servez de votre connaissance de l'Histoire sainte pour nous raconter, de l'Annonciation à la Nativité, le mystère divin de la venue au monde de Jésus et l'histoire simplement humaine de la Vierge et de Joseph qui accueillent dans leur couple cet enfant qui deviendra leur fils. La seule annonciation suffit à faire de Miriam, le vrai nom de Marie, une femme enceinte et Joseph, contre l'évidence de l'adultère, croit Miriam, sa promise, lutte contre sa famille et sa communauté et maintient au mois de septembre leurs épousailles. Le courage de Joseph et son amour pour Miriam sauvent la mère et l'enfant de la lapidation. Quelle belle figure masculine : « Joseph est une terre qui protège et nourrit la plante Miriam et lui permet de grandir et de porter son fruit » (écrirez-vous 7 ans plus tard dans Les saintes du scandale au chapitre Miriam). Ce court récit est l'histoire touchante d'un couple d'humains bouleversé par le mystère et la grâce. L’oeuvre - quand elle relève de l’urgence, de l’impulsion d’une nécessité et non d’un jeu - renvoie également à une forme de grâce. C’est ce que vous nous offrez avec ce récit magnifique de sobriété. //On peut s’enivrer de sobriété comme l’avaient compris les moines cisterciens de l’abbaye du Thoronet qui avaient inscrit cette devise sur la fontaine de leur cloître. En lisant Au nom de la mère on s’enivre de ce dépouillement qui semble relever d’une forme de grâce. On aurait peur de l’abîmer en le commentant.
Et je vais justement arrêter ce discours placé sous le signe de l’impression et du sensible pour ne pas céder à cette tentation. Pour conclure, je reviens à votre écriture. Avec une vie exceptionnelle et riche comme la vôtre, j’ai l’impression que, toujours à la recherche de l’âme des mots, c’est dans l’écriture que vous vous réalisez. Si j’ai parlé de grâce à propos de cette écriture, je ne voudrais pas que l’on pense que je voulais dire écriture aisée, facile, qui coule de source. Non, je pense qu’il s’agit d’une écriture exigeante stylistiquement et moralement, tellement vous craignez qu’elle tombe dans le mensonge. Ecrire c’est se rendre maître des mots. « Parler c’est parcourir un fil » avez-vous écrit. Je pense que les mots que vous savez réducteurs sont pour vous une préoccupation permanente. Ils évoquent dans l’immensité du vécu quelques points qui permettent d’éclairer le monde, de le penser, mais vous savez très bien qu’ils sont décevants, appauvrissants. La grâce fragile que vos lecteurs ressentent en vous lisant est celle d’un remarquable équilibriste. Je terminerai en vous citant : « La littérature est un point d’arrivée qui ne répond ni aux genres ni aux thèmes. Il survient, et alors c’est une fête pour celui qui lit ». Merci Erri de Luca pour cette fête, toujours neuve, que vous nous offrez.
Gérard Peylet, 4 avril 2016