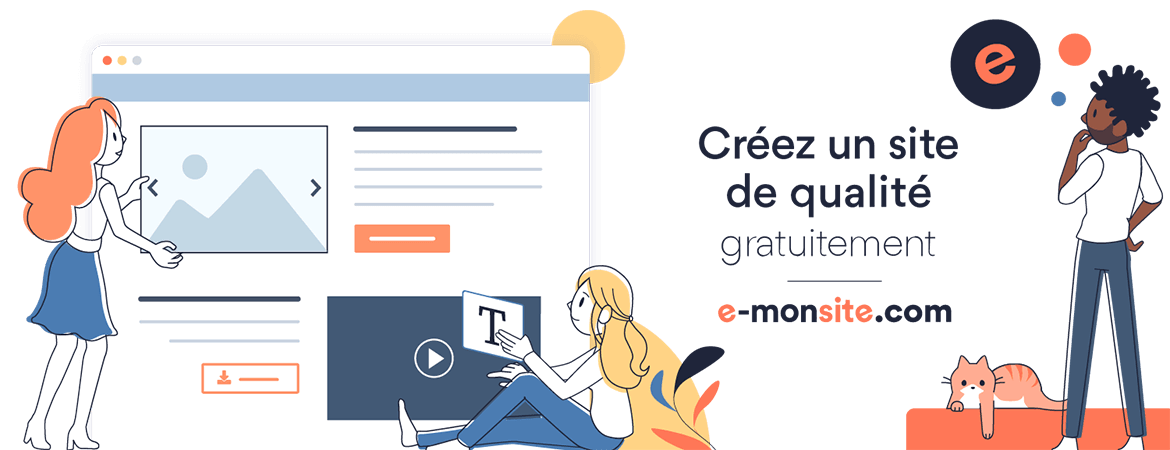Les Prix ARDUA 2013
Grand Prix ARDUA: PIERRE MICHON
Après son premier livre, Vies minuscules (1984), un classique de la littérature contemporaine, Pierre Michon a publié une douzaine de récits brefs et denses, concentrés autour de figures de peintres — Vie de Joseph Roulin (1988), Maîtres et serviteurs (1990) — ou d’écrivains : Rimbaud le fils (1991), Trois auteurs (1997). En 2002, il obtient le prix Décembre pour Abbés et Corps du roi. En 2007, il a publié un important recueil d’entretiens, Le Roi vient quand il veut. Propos sur la littérature. Il reçoit le Grand Prix du roman de l’Académie française pour Les Onze, en 2009.
Retour sur la remise du Prix le Mardi 16 Avril 2013
Le Mardi 16 Avril 2013 dans les salons de la Mairie de Bordeaux, le Grand Prix ARDUA a été remis à Pierre Michon pour l'ensemble de son oeuvre.
Lien vers un article paru dans Sud Ouest à cette occasion:
http://www.sudouest.fr/2013/04/17/pierre-michon-celebre-1027362-4720.php
Discours de remise du Grand Prix ARDUA 2013 à Pierre MICHON
16 avril 2013, Mairie de Bordeaux,
Par Gérard Peylet, Président de l'ARDUA
C’est un grand honneur, Pierre Michon, pour moi et pour nous tous ici, de vous remettre, aujourd’hui le grand Prix ARDUA. Ce Prix 2013 rend hommage à votre œuvre, originale, dense, très exigeante, que de nombreux spécialistes de la littérature actuelle considèrent comme une des plus importantes et des plus neuves aujourd’hui.
Il faut dire clairement pour éviter tout malentendu, que votre œuvre Pierre Michon n’est pas une œuvre régionaliste, pas plus que celle de Giono, celle de Mauriac ou celle du poète Jean Follain. C’est une œuvre qui nous plonge dans une méditation plus large sur l’être, dans le monde et dans le temps. Votre oeuvre n’est pas régionaliste même si le Limousin est une province fondatrice en ce qui concerne les Vies minuscules surtout, et dans une moindre mesure Les Onze et La grande Beune. Ce Limousin est chez vous une province poétique qui tend vers l’universel. Il n’est pas nécessaire de connaître les paysages qui entourent votre maison natale pour comprendre que l’espace représenté tend vers l’universel à partir de quelque chose de très intime qui a laissé une trace indélébile. La terre limousine des Vies minuscules possède quelque chose d’essentiel et d’éternel (comme chez Bergounioux et Richard Millet d’ailleurs) qui dépasse le régional.
On comprend bien que votre oeuvre s’enracine dans le terreau d’une filiation, mais si elle puise ses sources dans une expérience singulière et intime elle tend en même temps de toutes ses forces, je le disais, vers l’universel. Quant aux motifs limousins, ils sont tout de suite assimilés à la substance du monde. Ils ont beau se ressentir de l’origine, ils n’en conquièrent pas moins l’universalité. C’est que le Limousin de Michon, territoire géographiquement et poétiquement situé, s’élabore sous le signe d’une « Province poétique », d’un lieu fondateur, source de la parole. Plus qu’un référent réaliste, il offre une source inépuisable d’images, de métaphores. Le lieu réel n’est alors plus le lieu représenté, il devient un lieu « poétique ».
Mais cet espace est aussi du temps : il donne à voir un passé. Est-ce que d’ailleurs, le temps, celui des années d’enfance, n’est finalement pas aussi, voire plus important, que l’espace dans ce processus fondateur ? L’espace originel dans ce livre fondateur ne se confine pas au cadastre d’une province aimée dans l’enfance et rejetée plus tard : c’est la source vive de l’œuvre, la matrice fondamentale, dont l’œuvre se nourrit continûment car il correspond au terreau social et affectif des petites années d’enfance.
Toujours est-il que cette œuvre réalise à mes yeux, la synthèse du particulier et de l’universel, de « l’intime » et « l’immense », ce qui lui donne peut-être cette dimension poétique qui a tout de suite frappé mes étudiants.
Quant à la petite ferme des Cards qui ouvre et ferme le recueil, elle constitue un véritable lieu mythologique, « maison natale, tombe, temple et réservoir de deuil » d’après P.Michon lui-même.
Cette œuvre originale, je me tourne maintenant vers les arduans qui depuis 18 ans suivent la remise des Prix ARDUA, ne peut plus être classée selon les critères que nous avons l’habitude de suivre en remettant tantôt le Prix à un romancier, tantôt à un dramaturge, tantôt à un poète.
Votre œuvre, Pierre Michon – ce n’est pas la seule aujourd’hui qui remet en cause les distinctions génériques, mais la vôtre est exemplaire aussi de ce point de vue- tend à abolir les frontières génériques et formelles, sans artifice, -j’insiste sur ce point, « sans artifice »- je veux dire sans qu’il y ait de la part de l’écrivain un parti pris théorique d’innover à tout prix. Nous n’avons pas l’impression que Pierre Michon que certains considèrent comme un écrivain d’avant-garde se préoccupe de savoir si son œuvre est d’avant-garde ou si elle relève ou non de la post-modernité, ni que ces questions l’intéressent.
Comment cela serait-il possible avec une œuvre matrice qui ne relève surtout pas d’un concept ! C’est peut-être pour cela qu’elle a mis tant de temps – et c’est encore un aspect qui rend cette œuvre moderne si singulière, si à part- à être découverte comme une oeuvre majeure de notre époque. L’œuvre de Michon relève à la fois d’une nécessité intérieure et d’une exigence d’écriture. On ne peut séparer ces deux aspects. Quand elle arrive à maturité – l’auteur a 35 ans je crois quand il publie les Vies minuscules, elle est d’emblée poétique, à mi-chemin du récit et du poème, inclassable génériquement, ce qui ne veut pas dire que P.Michon n’a pas fortement ressenti que son projet, ne s’accordait plus à des formes anciennes comme le roman, formes un peu usées ou menacées à ses yeux, plus ou moins dépassées aujourd’hui par « le soupçon ».
J’aurais l’impression de vous trahir en vous appliquant l’étiquette de romancier même si vous avez écrit un roman original, les onze, (roman écrit sur un tableau, autour d’un tableau réalisé au moment de la Révolution, représentant le Comité de salut public. Encore une vie de peintre mais fictive cette fois-ci et un récit la Grande Beune qu’on peut lire bien sûr comme un roman bref alors qu’il s’agit plutôt d’un récit poétique, d’une nouvelle poétique qui a la dimension du mythe et qui révèle le renoncement au roman plus classique envisagé au début puis sacrifié (car il aurait été trop bavard, « fabriqué, ficelé et nécessairement tendu vers l’arbitraire d’une forme fatiguée : celle du petit objet de 300 pages qu’affectionne le marché sous le nom de roman » (Le roi vient quand il veut).
Nous retirons l’étiquette de romancier. Faut-il s’accrocher à tout prix à celle de biographie, genre que Michon renouvelle magnifiquement en revenant à l’origine du genre, les vies, ces récits de vie qui accordent toujours une place importante à la mort ? Pas complètement non plus, car le module de la vie devient chez lui source de la fiction .
Le narrateur biographe des VM, témoin de ces vies, de ces « doubles », est aussi un autobiographe. Ecrire la vie d’autrui permet à PM d’interroger son identité sans narcissisme, avec un recul mélancolique. La biographie est un miroir mélancolique et épouse l’autobiographie de l’auteur . « En elle il s’invente, il se crée ». Et les Vies minuscules sont de toute façon plus qu’un texte hybride composé de biographie et d’autobiographie.
Si l’on peut encore utiliser le terme de biographie ou de Vie pour Rimbaud le fils (ouvre de commande d’après Michon) ou la Vie de Joseph Roulin (superbe texte où le grand homme Van Gogh est regardé du point de vue du minuscule, Roulin), dans quelle catégorie littéraire, je ne dis pas genre (– celui des Vies peut-être, encore à première vue, si on regarde la démarche initiale) pourrait-on ranger les trois textes poétiques, denses et puissants, cruels et raffinés à la fois qui constituent Abbés ? On sait que P.Michon a exhumé des archives des vies qui ont existé. Il faut ici souligner l’inscription étonnante des savoirs, de la documentation comme soubassement de l’œuvre même si l’écrivain ne l’utilise pas directement.
S’il subvertit ces formes anciennes –comme le roman, la fiction, la Vie ou la biographie, l’autobiographie également- pour trouver l’écriture qui coïncide le plus exactement possible à son projet personnel, c’est, je le répète, poussé par une nécessité interne, pas gratuitement.
Pour revenir au livre premier (que j’invite ceux qui se trouvent réunis aujourd’hui dans ces salons à lire si ce n’est déjà fait, car il faut commencer par ce livre pour apprécier les autres), j’avoue qu’il a empoigné le 19iste que je suis d’une façon profonde, durable, en me donnant l’envie de transmettre l’émotion poétique que j’avais ressentie dès la première lecture, dès la première lecture de « la première vie ».
J’ai entendu tout de suite, en vous lisant la première fois, une voix nouvelle dans notre littérature contemporaine, à la fois fraternelle, accessible à la compassion mais ironique aussi (une ironie plus proche dérision, du sarcasme que de l’ironie voltairienne), une voix nouvelle où une forme de tendresse et de pitié à la fois côtoie le sarcasme et la dérision.
C’est l’occasion ici de rendre hommage à ce bouleversant « minuscule » qui illumine le titre, bouleversant, car il n’est pas né d’un concept mais d’une intuition profonde qui n’entraîne ni minimalisme dans l’écriture ni misérabilisme dans la représentation. Bien plus qu’une idée qui aurait été une simple construction, il épouse ce minuscule une pensée beaucoup plus complexe, vivante, que l’on pressent être la matrice de toute l’œuvre, une pensée poétique qui seule peut saisir cet emmêlement originel sans fêlure ni réduction qu’il y a dans tout phénomène humain profond. Ce mot – mais ce n’est pas un spécialiste de la littérature contemporaine qui parle- est peut-être la clé de voûte de votre œuvre. Les minuscules, ce sont ces vies d’hommes qui ne sont pas illustres, les existences obscures de petites gens dont l’itinéraire a croisé le vôtre, mais plus que cela aussi. Quand on lit la fin de la seconde vie qui se termine par l’évocation du cimetière de St-Goussaud, on comprend que les minuscules ce sont d’abord les morts mais aussi les vivants dans leur relation aux morts. Dans une interview, j’ai noté que vous citiez Villon « Frères humains qui après nous vivez », les morts qui parlent aux vivants. Vous ajoutez : la littérature sert vraiment à quelque chose : faire parler des morts à des vivants. Comme l’a bien dit Agnès Castiglione qui a écrit un livre si juste sur votre œuvre, « votre art est un art d’évocation ». Pour revenir à l’évocation du cimetière de Saint Goussaud, A.Castiglione rapporte qu’on allumait pour chaque défunt un grand feu qui illuminait dans la nuit toutes les vallées environnantes comme une petite âme pour la Pentecôte et elle écrit « La lanterne des morts est le phare de cette écriture du deuil et de la résurrection ». Deuil, résurrection, tout est dit magnifiquement, magistralement, simplement avec deux mots.
Ecriture du deuil et de la résurrection, ce livre matrice tisse un passage entre les morts et les vivants, le narrateur. Pour la mort, ressentie comme un passage irréversible dans l’existence des hommes, toute société élabore les rituels d’un commerce symbolique que doivent entretenir les vivants avec les morts. Entre ceux qui restent et ceux qui disparaissent s’instaurent des liens, auxquels l’imaginaire avec ses singularités et ses codes infuse une dynamique singulière. C’est cette relation essentielle avec les morts, cette continuité d’une transmission, qui fait des morts évoqués un capital symbolique essentiel. Au coeur de cette délicate interrogation, si intime et personnelle d’un "passage" dans votre premier livre, est ancrée la relation de filiation, cette énigme essentielle puisque l’être qui pense et imagine le passage s’inscrit avec inquiétude dans le fil de sa propre durée. Le narrateur, vous, témoin et relais dans la chaîne des filiations et générations, transforme une existence disparue en Vie, vie littéraire. L’art confère alors une forme de plénitude à l’absence des défunts, donne sens à la mort. C’est un passage, une transmission. Mais cette relation se complique et se double dans le cas des Vies minuscules de l’absence de la figure du père. De cette absence –faut-il dire centrale, je ne sais mais il n’en est pas moins certain qu’il s’agit d’une figure en creux- de ce manque initial, est peut-être parti le désir de l’écriture compensatrice.
Cette rapide présentation ne peut donner une idée même un peu complète de l’art de Pierre Michon. Comment dire aussi ce qui n’est jamais expliqué, défini mais que l’on ressent dans tous les textes et pas seulement dans le premier, cette recherche d’une transcendance indéfinissable, cette aspiration au sublime, ce que P.Michon appelle lui-même dans Le roi qui vient quand il veut « ce sentiment très vacillant du sacré (un sacré dont nul Dieu n’est plus garant » car la langue poétique fabrique sans cesse de la transcendance. Dans ce livre d’entretiens, P.Michon considère que la « la littérature est une forme déchue de la prière, la prière d’un monde sans Dieu » et il ajoute que l’écrivain a besoin de cette assomption, a besoin que son texte se hausse au-dessus de celui qui l’écrit. Michon n’est pas loin de penser que l’oeuvre – quand elle relève de l’urgence, de l’impulsion d’une nécessité et non d’un jeu- renvoie à une forme de grâce, est peut-être la seule preuve de la grâce (il faudra aussi lors du colloque, l’an prochain, se pencher sur cette notion). Je cite Pierre Michon « Cette grande dynamique qui m’emporte dans le monde au moment où j’écris, voilà ce que j’appelle Dieu » (Le roi quand il vient).
Une présentation n’est pas une étude. J’espère avoir désigné quelques pistes que nous ne manquerons pas de suivre au moment du colloque dans un an :
- la liberté de Michon par rapport aux genres. Pourquoi écrit-il dans une forme qui n’a pas de nom ?
- la jouissance d’écrire dans la brièveté, pas seulement pour fuir le piège de la production mais sous l’impulsion d’une nécessité intérieure
- la recherche d’un sens jamais établi, préétabli à l’avance, un sens qui tire l’écrivain en avant sans qu’il sache exactement où il va
- sa sympathie –le mot est faible- pour Flaubert, et ce qui me touche particulièrement un Flaubert romantique, une certaine affinité avec le romantisme…
- les tensions qui structurent en profondeur une écriture à la fois de la discontinuité (avec ces blancs, ce vide) et des liens qu’elle tisse d’une œuvre à l’autre, tension aussi entre le sacré et le profane…
- la mélancolie que l’on sent si fondatrice de l’œuvre, son lien avec le sublime, et si profonde, car il n’y a pas de temps retrouvé. Mélancolie d’une œuvre qui se construit entre présence et absence.
- La beauté enfin de l’écriture, à la fois brute et maîtrisée, une violence maîtrisée comme chez Flaubert. Le rythme de cette écriture qui fait surgir ces personnages des VM, ou la figure de J Roulin, ou celles des abbés, du néant, par la puissance du verbe. Superbe langue classique revitalisée par des failles, des ruptures, phrase si difficile à analyser pour le professeur de Lettres qui tente de le faire, mais, somptueuse, entre prose et poésie, entre classicisme (la grande période classique) et la subversion subtile du modèle classique. Phrase qui a l’air classique et qui explose en quelque chose d’unique, phrase qui rythme la langue dans l’émoi. Et donne une présence intense, tangible aux paysages, aux êtres et aux choses.
Prix Littéraire ARDUA: JEAN-YVES LAURICHESSE
Professeur de littérature française à l’Université de Toulouse-Le Mirail, spécialiste de Giono, Claude Simon et Richard Millet, Jean-Yves Laurichesse publie régulièrement des romans depuis 2008 aux éditions Le temps qu’il fait :
Un triptyque relevant du « récit de filiation » : Place Monge (2008), inspiré par l’histoire de ses grands-parents paternels, à partir d’archives familiales (lettres, photographies, documents officiels), Les pas de l’ombre (2009), autour de la figure de son père, à partir de récits oraux et de lettres de captivité, Les brisées (à paraître en avril 2013), autour de sa propre mémoire d’enfance et d’adolescence, et de sa relation à la littérature.
Une fiction, L’hiver en Arcadie (2011), l’histoire d’un voyageur accueilli dans une maison par un couple (lui écrivain, elle pianiste), au milieu d’un paysage hivernal inspiré de la Corrèze, avec une dimension discrètement onirique.
Discours de remise du Grand Prix ARDUA 2013 à Pierre MICHON
16 avril 2013, Mairie de Bordeaux,
Par Gérard Peylet, Président de l'ARDUA
C’est un grand honneur, Pierre Michon, pour moi et pour nous tous ici, de vous remettre, aujourd’hui le grand Prix ARDUA. Ce Prix 2013 rend hommage à votre œuvre, originale, dense, très exigeante, que de nombreux spécialistes de la littérature actuelle considèrent comme une des plus importantes et des plus neuves aujourd’hui.
Il faut dire clairement pour éviter tout malentendu, que votre œuvre Pierre Michon n’est pas une œuvre régionaliste, pas plus que celle de Giono, celle de Mauriac ou celle du poète Jean Follain. C’est une œuvre qui nous plonge dans une méditation plus large sur l’être, dans le monde et dans le temps. Votre oeuvre n’est pas régionaliste même si le Limousin est une province fondatrice en ce qui concerne les Vies minuscules surtout, et dans une moindre mesure Les Onze et La grande Beune. Ce Limousin est chez vous une province poétique qui tend vers l’universel. Il n’est pas nécessaire de connaître les paysages qui entourent votre maison natale pour comprendre que l’espace représenté tend vers l’universel à partir de quelque chose de très intime qui a laissé une trace indélébile. La terre limousine des Vies minuscules possède quelque chose d’essentiel et d’éternel (comme chez Bergounioux et Richard Millet d’ailleurs) qui dépasse le régional.
On comprend bien que votre oeuvre s’enracine dans le terreau d’une filiation, mais si elle puise ses sources dans une expérience singulière et intime elle tend en même temps de toutes ses forces, je le disais, vers l’universel. Quant aux motifs limousins, ils sont tout de suite assimilés à la substance du monde. Ils ont beau se ressentir de l’origine, ils n’en conquièrent pas moins l’universalité. C’est que le Limousin de Michon, territoire géographiquement et poétiquement situé, s’élabore sous le signe d’une « Province poétique », d’un lieu fondateur, source de la parole. Plus qu’un référent réaliste, il offre une source inépuisable d’images, de métaphores. Le lieu réel n’est alors plus le lieu représenté, il devient un lieu « poétique ».
Mais cet espace est aussi du temps : il donne à voir un passé. Est-ce que d’ailleurs, le temps, celui des années d’enfance, n’est finalement pas aussi, voire plus important, que l’espace dans ce processus fondateur ? L’espace originel dans ce livre fondateur ne se confine pas au cadastre d’une province aimée dans l’enfance et rejetée plus tard : c’est la source vive de l’œuvre, la matrice fondamentale, dont l’œuvre se nourrit continûment car il correspond au terreau social et affectif des petites années d’enfance.
Toujours est-il que cette œuvre réalise à mes yeux, la synthèse du particulier et de l’universel, de « l’intime » et « l’immense », ce qui lui donne peut-être cette dimension poétique qui a tout de suite frappé mes étudiants.
Quant à la petite ferme des Cards qui ouvre et ferme le recueil, elle constitue un véritable lieu mythologique, « maison natale, tombe, temple et réservoir de deuil » d’après P.Michon lui-même.
Cette œuvre originale, je me tourne maintenant vers les arduans qui depuis 18 ans suivent la remise des Prix ARDUA, ne peut plus être classée selon les critères que nous avons l’habitude de suivre en remettant tantôt le Prix à un romancier, tantôt à un dramaturge, tantôt à un poète.
Votre œuvre, Pierre Michon – ce n’est pas la seule aujourd’hui qui remet en cause les distinctions génériques, mais la vôtre est exemplaire aussi de ce point de vue- tend à abolir les frontières génériques et formelles, sans artifice, -j’insiste sur ce point, « sans artifice »- je veux dire sans qu’il y ait de la part de l’écrivain un parti pris théorique d’innover à tout prix. Nous n’avons pas l’impression que Pierre Michon que certains considèrent comme un écrivain d’avant-garde se préoccupe de savoir si son œuvre est d’avant-garde ou si elle relève ou non de la post-modernité, ni que ces questions l’intéressent.
Comment cela serait-il possible avec une œuvre matrice qui ne relève surtout pas d’un concept ! C’est peut-être pour cela qu’elle a mis tant de temps – et c’est encore un aspect qui rend cette œuvre moderne si singulière, si à part- à être découverte comme une oeuvre majeure de notre époque. L’œuvre de Michon relève à la fois d’une nécessité intérieure et d’une exigence d’écriture. On ne peut séparer ces deux aspects. Quand elle arrive à maturité – l’auteur a 35 ans je crois quand il publie les Vies minuscules, elle est d’emblée poétique, à mi-chemin du récit et du poème, inclassable génériquement, ce qui ne veut pas dire que P.Michon n’a pas fortement ressenti que son projet, ne s’accordait plus à des formes anciennes comme le roman, formes un peu usées ou menacées à ses yeux, plus ou moins dépassées aujourd’hui par « le soupçon ».
J’aurais l’impression de vous trahir en vous appliquant l’étiquette de romancier même si vous avez écrit un roman original, les onze, (roman écrit sur un tableau, autour d’un tableau réalisé au moment de la Révolution, représentant le Comité de salut public. Encore une vie de peintre mais fictive cette fois-ci et un récit la Grande Beune qu’on peut lire bien sûr comme un roman bref alors qu’il s’agit plutôt d’un récit poétique, d’une nouvelle poétique qui a la dimension du mythe et qui révèle le renoncement au roman plus classique envisagé au début puis sacrifié (car il aurait été trop bavard, « fabriqué, ficelé et nécessairement tendu vers l’arbitraire d’une forme fatiguée : celle du petit objet de 300 pages qu’affectionne le marché sous le nom de roman » (Le roi vient quand il veut).
Nous retirons l’étiquette de romancier. Faut-il s’accrocher à tout prix à celle de biographie, genre que Michon renouvelle magnifiquement en revenant à l’origine du genre, les vies, ces récits de vie qui accordent toujours une place importante à la mort ? Pas complètement non plus, car le module de la vie devient chez lui source de la fiction .
Le narrateur biographe des VM, témoin de ces vies, de ces « doubles », est aussi un autobiographe. Ecrire la vie d’autrui permet à PM d’interroger son identité sans narcissisme, avec un recul mélancolique. La biographie est un miroir mélancolique et épouse l’autobiographie de l’auteur . « En elle il s’invente, il se crée ». Et les Vies minuscules sont de toute façon plus qu’un texte hybride composé de biographie et d’autobiographie.
Si l’on peut encore utiliser le terme de biographie ou de Vie pour Rimbaud le fils (ouvre de commande d’après Michon) ou la Vie de Joseph Roulin (superbe texte où le grand homme Van Gogh est regardé du point de vue du minuscule, Roulin), dans quelle catégorie littéraire, je ne dis pas genre (– celui des Vies peut-être, encore à première vue, si on regarde la démarche initiale) pourrait-on ranger les trois textes poétiques, denses et puissants, cruels et raffinés à la fois qui constituent Abbés ? On sait que P.Michon a exhumé des archives des vies qui ont existé. Il faut ici souligner l’inscription étonnante des savoirs, de la documentation comme soubassement de l’œuvre même si l’écrivain ne l’utilise pas directement.
S’il subvertit ces formes anciennes –comme le roman, la fiction, la Vie ou la biographie, l’autobiographie également- pour trouver l’écriture qui coïncide le plus exactement possible à son projet personnel, c’est, je le répète, poussé par une nécessité interne, pas gratuitement.
Pour revenir au livre premier (que j’invite ceux qui se trouvent réunis aujourd’hui dans ces salons à lire si ce n’est déjà fait, car il faut commencer par ce livre pour apprécier les autres), j’avoue qu’il a empoigné le 19iste que je suis d’une façon profonde, durable, en me donnant l’envie de transmettre l’émotion poétique que j’avais ressentie dès la première lecture, dès la première lecture de « la première vie ».
J’ai entendu tout de suite, en vous lisant la première fois, une voix nouvelle dans notre littérature contemporaine, à la fois fraternelle, accessible à la compassion mais ironique aussi (une ironie plus proche dérision, du sarcasme que de l’ironie voltairienne), une voix nouvelle où une forme de tendresse et de pitié à la fois côtoie le sarcasme et la dérision.
C’est l’occasion ici de rendre hommage à ce bouleversant « minuscule » qui illumine le titre, bouleversant, car il n’est pas né d’un concept mais d’une intuition profonde qui n’entraîne ni minimalisme dans l’écriture ni misérabilisme dans la représentation. Bien plus qu’une idée qui aurait été une simple construction, il épouse ce minuscule une pensée beaucoup plus complexe, vivante, que l’on pressent être la matrice de toute l’œuvre, une pensée poétique qui seule peut saisir cet emmêlement originel sans fêlure ni réduction qu’il y a dans tout phénomène humain profond. Ce mot – mais ce n’est pas un spécialiste de la littérature contemporaine qui parle- est peut-être la clé de voûte de votre œuvre. Les minuscules, ce sont ces vies d’hommes qui ne sont pas illustres, les existences obscures de petites gens dont l’itinéraire a croisé le vôtre, mais plus que cela aussi. Quand on lit la fin de la seconde vie qui se termine par l’évocation du cimetière de St-Goussaud, on comprend que les minuscules ce sont d’abord les morts mais aussi les vivants dans leur relation aux morts. Dans une interview, j’ai noté que vous citiez Villon « Frères humains qui après nous vivez », les morts qui parlent aux vivants. Vous ajoutez : la littérature sert vraiment à quelque chose : faire parler des morts à des vivants. Comme l’a bien dit Agnès Castiglione qui a écrit un livre si juste sur votre œuvre, « votre art est un art d’évocation ». Pour revenir à l’évocation du cimetière de Saint Goussaud, A.Castiglione rapporte qu’on allumait pour chaque défunt un grand feu qui illuminait dans la nuit toutes les vallées environnantes comme une petite âme pour la Pentecôte et elle écrit « La lanterne des morts est le phare de cette écriture du deuil et de la résurrection ». Deuil, résurrection, tout est dit magnifiquement, magistralement, simplement avec deux mots.
Ecriture du deuil et de la résurrection, ce livre matrice tisse un passage entre les morts et les vivants, le narrateur. Pour la mort, ressentie comme un passage irréversible dans l’existence des hommes, toute société élabore les rituels d’un commerce symbolique que doivent entretenir les vivants avec les morts. Entre ceux qui restent et ceux qui disparaissent s’instaurent des liens, auxquels l’imaginaire avec ses singularités et ses codes infuse une dynamique singulière. C’est cette relation essentielle avec les morts, cette continuité d’une transmission, qui fait des morts évoqués un capital symbolique essentiel. Au coeur de cette délicate interrogation, si intime et personnelle d’un "passage" dans votre premier livre, est ancrée la relation de filiation, cette énigme essentielle puisque l’être qui pense et imagine le passage s’inscrit avec inquiétude dans le fil de sa propre durée. Le narrateur, vous, témoin et relais dans la chaîne des filiations et générations, transforme une existence disparue en Vie, vie littéraire. L’art confère alors une forme de plénitude à l’absence des défunts, donne sens à la mort. C’est un passage, une transmission. Mais cette relation se complique et se double dans le cas des Vies minuscules de l’absence de la figure du père. De cette absence –faut-il dire centrale, je ne sais mais il n’en est pas moins certain qu’il s’agit d’une figure en creux- de ce manque initial, est peut-être parti le désir de l’écriture compensatrice.
Cette rapide présentation ne peut donner une idée même un peu complète de l’art de Pierre Michon. Comment dire aussi ce qui n’est jamais expliqué, défini mais que l’on ressent dans tous les textes et pas seulement dans le premier, cette recherche d’une transcendance indéfinissable, cette aspiration au sublime, ce que P.Michon appelle lui-même dans Le roi qui vient quand il veut « ce sentiment très vacillant du sacré (un sacré dont nul Dieu n’est plus garant » car la langue poétique fabrique sans cesse de la transcendance. Dans ce livre d’entretiens, P.Michon considère que la « la littérature est une forme déchue de la prière, la prière d’un monde sans Dieu » et il ajoute que l’écrivain a besoin de cette assomption, a besoin que son texte se hausse au-dessus de celui qui l’écrit. Michon n’est pas loin de penser que l’oeuvre – quand elle relève de l’urgence, de l’impulsion d’une nécessité et non d’un jeu- renvoie à une forme de grâce, est peut-être la seule preuve de la grâce (il faudra aussi lors du colloque, l’an prochain, se pencher sur cette notion). Je cite Pierre Michon « Cette grande dynamique qui m’emporte dans le monde au moment où j’écris, voilà ce que j’appelle Dieu » (Le roi quand il vient).
Une présentation n’est pas une étude. J’espère avoir désigné quelques pistes que nous ne manquerons pas de suivre au moment du colloque dans un an :
- la liberté de Michon par rapport aux genres. Pourquoi écrit-il dans une forme qui n’a pas de nom ?
- la jouissance d’écrire dans la brièveté, pas seulement pour fuir le piège de la production mais sous l’impulsion d’une nécessité intérieure
- la recherche d’un sens jamais établi, préétabli à l’avance, un sens qui tire l’écrivain en avant sans qu’il sache exactement où il va
- sa sympathie –le mot est faible- pour Flaubert, et ce qui me touche particulièrement un Flaubert romantique, une certaine affinité avec le romantisme…
- les tensions qui structurent en profondeur une écriture à la fois de la discontinuité (avec ces blancs, ce vide) et des liens qu’elle tisse d’une œuvre à l’autre, tension aussi entre le sacré et le profane…
- la mélancolie que l’on sent si fondatrice de l’œuvre, son lien avec le sublime, et si profonde, car il n’y a pas de temps retrouvé. Mélancolie d’une œuvre qui se construit entre présence et absence.
- La beauté enfin de l’écriture, à la fois brute et maîtrisée, une violence maîtrisée comme chez Flaubert. Le rythme de cette écriture qui fait surgir ces personnages des VM, ou la figure de J Roulin, ou celles des abbés, du néant, par la puissance du verbe. Superbe langue classique revitalisée par des failles, des ruptures, phrase si difficile à analyser pour le professeur de Lettres qui tente de le faire, mais, somptueuse, entre prose et poésie, entre classicisme (la grande période classique) et la subversion subtile du modèle classique. Phrase qui a l’air classique et qui explose en quelque chose d’unique, phrase qui rythme la langue dans l’émoi. Et donne une présence intense, tangible aux paysages, aux êtres et aux choses.