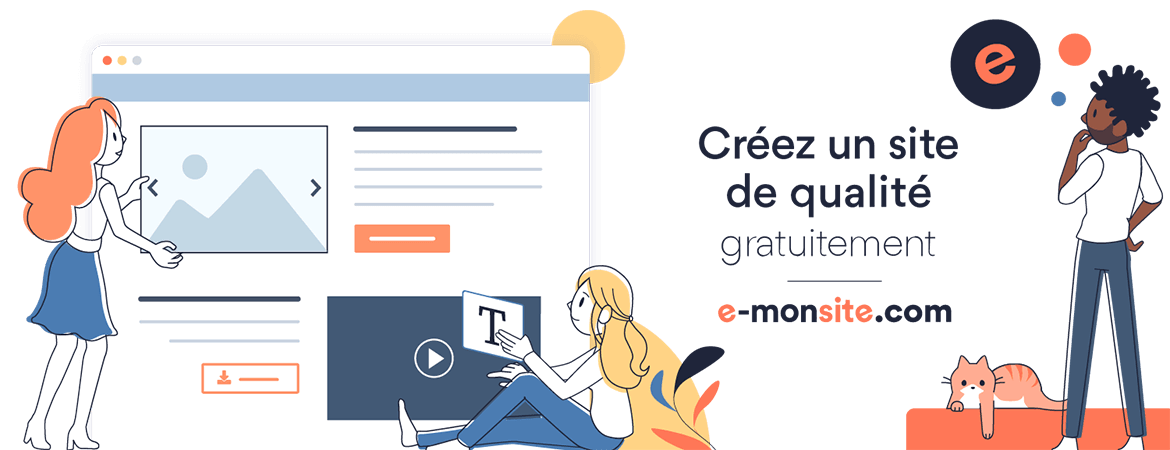Remise du Grand Prix ARDUA 2012
Discours de remise du Grand prix ARDUA 2012
 Mairie de Bordeaux 11 avril : remise Grand Prix ARDUA à Eric Emmanuel Schmitt
Mairie de Bordeaux 11 avril : remise Grand Prix ARDUA à Eric Emmanuel Schmitt
Par Gérard Peylet, Président de l’ARDUA,
Tous les arduans présents aujourd’hui dans ces salons, pensent comme moi, avec émotion, en cet instant, à notre amie Yolande Legrand qui a fondé l’ARDUA il y a 17 ans et que nous avions tant de plaisir et de fierté à retrouver chaque année à
C’est un grand honneur, Monsieur Eric Emmanuel Schmitt, pour moi et pour nous tous ici, de vous remettre, aujourd’hui le grand Prix ARDUA. Ce Prix, nous n’en doutons pas, est la promesse d’un beau colloque qui se tiendra à Bordeaux, dans un an, pour rendre hommage à votre œuvre, originale et diverse et, déjà, d’une grande ampleur.
Faut-il rappeler d’abord qu’Agrégé de philosophie, vous vous êtes d'abord fait connaître au théâtre, notamment avec Le Visiteur devenu un classique du répertoire international, que vos pièces, plébiscitées par le public, ont été récompensées par plusieurs Molière et le Grand Prix du théâtre de l'Académie française, que vos livres sont traduits aujourd’hui en 43 langues et que plus de 50 pays jouent régulièrement vos pièces. Mais je n’en dirai pas plus sur votre célébrité de même que je n’énumérerai pas la liste de toutes vos œuvres théâtrales ou narratives!
[…] Lorsque ma plus jeune fille, ici présente, a lu avec enthousiasme en seconde ou première La nuit de Valognes, j’ai lu à mon tour cette pièce et j’ai été séduit tout de suite par cette réactualisation mélancolique du mythe de Dom Juan, réactualisation mélancolique car votre personnage est un être fatigué qui s’exprime dans un monde usé. Sa quête – il ne peut pas y avoir de figure de Dom Juan sans quête - n’en demeure que plus fragile, incertaine, et je trouve, émouvante dans ses incertitudes. Quête de soi, de son identité intimement mêlée à la quête de l’autre. […]
Je reviens à cette notion de mélancolie que j’évoquais à propos de votre première pièce de théâtre, j’y reviens, car mon intention est de faire une présentation personnelle de votre œuvre, et aussi parce qu’elle me paraît très intéressante chez un écrivain aussi solide que vous, (c’est l’impression que vous donnez quand on vous voit, quand on vous écoute, celle d’une force vitale assez exceptionnelle) chez un écrivain aussi positif, aussi humaniste. Il me semble que l’ensemble de votre œuvre contient pourtant beaucoup de nuances, de nombreuses et diverses formes de mélancolie. Je citerai La rêveuse d’Ostende, Concerto à
La modernité a tendance à refuser le vide intérieur, puisqu’elle a pour objectif de satisfaire la totalité de nos désirs, quitte à inventer de nouveaux désirs pour les satisfaire de nouveau. Nous vivons dans le monde de la saturation, du trop plein et du toujours plus. Comment faire pour retrouver un sens à la vie qui ne se limite pas à l’avoir, à la possession de biens matériels ? Votre œuvre, je trouve, soulève, sous différents angles, cette question. Socrate nous a expliqué voici 25 siècles que celui qui sait, c’est celui qui sait qu’il ne sait pas. Cette expérience, c’est si j’ai bien lu votre dernier roman, celle que fait Anne de Bruges, celle que l’actrice hollywoodienne Annie finira par faire à son tour intuitivement en rejoignant la première, Anne, par le don de soi.
Savoir que nous ne savons pas, c’est accepter une carence en nous. En essayant de combler ce vide, nous pouvons commencer à chercher, comme Adolphe H, le double antagoniste d’Hitler. La recherche sincère demande de l’humilité. C’est précisément cette recherche que vous mettez en œuvre, sans didactisme, je m’empresse de le dire, dans vos deux grands textes qui sont à la fois des romans et plus que des romans, L’Evangile selon Pilate, La part de l’autre, et que l’on retrouve aussi dans votre dernier roman La Femme au Miroir. Celui qui accepte le vide en soi a suffisamment de vide en lui pour que l’Amour puisse s’y engouffrer. C’est ce que comprend Annie à la fin de
Votre première pièce, j’y reviens après ce long détour sur la mélancolie, La nuit de Valognes, « nourrie de musique et d’opéra » (autre thème important que je n’aurais pas le temps de développer) est bien le premier texte que j’ai lu de vous qui m’a introduit dans cet univers complexe qui explore la difficulté d’être un homme, qui questionne la notion de désir dans l’être humain plus que celle du plaisir, qui s’aventure avec beaucoup de finesse aux frontières du visible et de l’invisible, cette dimension de votre œuvre qui me touche.
J’ai admiré votre talent pour incarner des idées. Vous n’écrivez pas des pièces à thèse, des romans à thèse, des nouvelles à thèse même si vous avez déclaré que « le roman ne vous intéresse que s’il est philosophique, qu’il doit provoquer la réflexion ». Le secret de cette réussite me semble être la force de l’imaginaire que contiennent vos livres, le lien, pas du tout artificiel, qui se tisse entre philosophie et imaginaire. Votre pensée se fond dans un imaginaire qui me semble toujours premier dans la création des personnages que vous mettez en œuvre. Dans « Le Journal d’écriture » du Concerto à la mémoire d’un ange vous éclairez d’ailleurs votre démarche créatrice : « L’idée du livre précède les nouvelles, elle convoque et crée les nouvelles dans mon imagination ». Dans le « Journal d’un roman volé » qui sert de postface à L’Evangile selon Pilate, vous donnez vous-même une définition du rôle premier de l’imaginaire dans vos créations :
« Certes, « roman » signifie subjectif, imaginaire, mais ne signifie pas irréel ni dépourvu de sens. Il est des réalités qui ne peuvent se transcrire dans aucun autre langage. Je me demande si certaines vérités ne sont pas inexprimables autrement que sous la forme d’histoires, de romans, de contes… »
Vous définissez là très bien cette vérité de l’imaginaire qui n’est pas tout à fait celle de la philosophie conceptuelle. C’est cette puissance de l’imaginaire dans votre œuvre qui convertit la nourriture philosophique, le terreau philosophique en art, en sensibilité, en émotion. Vous ne vous trompez pas de cheminement. C’est l’intuition, l’émotion, l’image qui donne de la force aux idées.
Les idées vous les incarnez parce que vous les habitez, vous les vivez dans votre esprit, dans votre corps, dans votre coeur. Je vous cite encore à propos de La part de l’autre : « Le monstre m’habite comme il habite tout homme, comme il habite l’humanité. Il est de notre responsabilité de le tenir toute notre vie en cage ou de le libérer…Ce roman philosophique est devenu, dans sa lecture comme dans son écriture, une épreuve philosophique. Un exercice de lucidité doublé d’un appel à la vigilance »
Le roman tout entier donne vie et chair aux idées. En 1936, Albert Camus avait inscrit dans son Journal la phrase suivante : « On ne pense que par image. Si tu veux être philosophe, écris des romans ». Votre œuvre me paraît bien répondre à ce souhait d’A. Camus. Pour Camus, l’idée est une simple construction mais la pensée est beaucoup plus complexe, vivante, « c’est un processus qui consiste à son tour à re-présenter en images une réalité par définition fuyante et obscure ». L’image pense au moins autant –mais différemment- que le concept. Il faut la prise de l’image, de l’imaginaire et du mythe pour saisir cet emmêlement originel sans fêlure ni réduction qu’il y a dans tout phénomène humain.
Seul l’imaginaire précisément, une pensée imaginative, pouvait aborder la part de l’invisible qui est essentielle dans le destin des hommes, pouvait aborder le mystère de l’homme. A la fin de
Quel autre moyen que l’imaginaire et le mode poétique de l’intuition pour appréhender le mystère ?
Dans vos livres, le mystère n’est jamais dévoilé, mais il est éclairé dans toutes ses dimensions, physiologique, psychique, spirituelle. Il n’est jamais complètement dévérouillé, découpé, analysé, car il ne peut être que pressenti dans sa totalité par l’imagination, la sensibilité, qui ne découpent pas, ne segmentent pas ce qui par définition ne peut pas l’être. Une fois encore le témoignage que vous laissez à la fin de L’Evangile selon Pilate est précieux pour comprendre à ce niveau votre démarche:
« Au fond de moi il y a autre chose que moi. M’y attendent des sentiments, des pensées, des états qui n’appartiennent pas à l’ordinaire de ma personnalité. D’où naît cette surprise qu’on appelle l’inspiration ? Des expériences accumulées, d’un cœur plus large que l’esprit, d’un inconscient plus riche que la conscience ? Des autres vivants ou morts, qui s’emparent de mon imagination pour s’exprimer ? Est-ce une mémoire génétique, celle de l’humanité, devenue enfin accessible ? Est-ce l’entrée dans un état de résonance avec le monde, une sorte de sixième sens que la science ignore encore ? Est-ce saisir un murmure divin ? Je crois toutes ces hypothèses probables…
Lorsque j’écris, je fais l’expérience d’une altérité. Je suis autant scribe qui écoute qu’écrivain qui créé.
J’aborde un infini, un univers sans bornes…Seules les limites m’appartiennent en propre »
J’aimerais m’arrêter enfin sur quatre œuvres qui illustrent bien cette déclaration que vous avez faite dans le Journal d’un roman volé.
Un récit d’abord, particulier, puisqu’il a d’abord été une pièce de théâtre, un monologue, qu’il est aussi devenu un film et que l’on pourrait qualifier de fable moderne : Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran. En lisant ce conte actuel on pense à l’œuvre la plus célèbre d’Emile Ajar alias Romain Gary, La vie devant soi, tellement, à première, vue les deux sujets semblent proches. Dans les deux cas, on retrouve cette idée fondamentale et/ou fondatrice que seul l’enfant peut amener le vieillard jusqu’au bout de son ultime pèlerinage, de son ultime quête mystique, on retrouve le même lien intergénérationnel, la même amitié prépondérante. Comme malgré tout les deux œuvres ne se ressemblent pas, et dans le genre choisi, dans l’écriture et finalement aussi dans le sens, on ne peut qu’admirer cette fonction première de la littérature, celle de « passeur » entre deux rives, entre deux imaginaires. Romain Gary écrit un roman, vous écrivez une pièce de théâtre et une sorte de conte moderne qui suscite la réflexion en faisant appel à l’imagination du lecteur. Ce n’est pas seulement l’histoire d’une amitié intergénérationnelle entre un enfant délaissé et un vieil homme seul que vous racontez, c’est aussi l’histoire d’une transmission, transmission de valeurs, de sentiments, d’émotions que l’un découvre au contact de l’autre et réciproquement. Transmission surtout de cet espoir – propre de l’Homme sans doute - qui demeure le seul ressort de la survivance quand il s’agit de combler le manque de la perte des êtres chers, celle d’une mère ou celle d’une épouse. Chacun de vos personnages apporte à l’autre le bonheur, ils vont se changer la vie, chacun donne à l’autre. Cette histoire de transmission est surtout celle de la création du lien entre deux êtres quand ce lien passe par le don. Vos deux personnages incarnent avec beaucoup de fraîcheur L’esprit du don (pour reprendre le titre d’un ouvrage du sociologue québecquois Jacques Godbout).
Une nouvelle ensuite. Avant d’être romancier vous avez été novelliste, vous méfiant un peu de la liberté qu’offrait le roman :
« Le roman m'offrait une liberté qui m'a longtemps effrayé, une liberté qui pouvait devenir licence. Pourquoi gribouiller 300 pages plutôt que 100 ? Jusqu'à quel point décrire ? Quel point de vue adopter ? Fort heureusement, les sujets de mes livres m'ont forcé la main : ils se sont imposés, m'ont obligé à les écouter, à rédiger leur histoire pendant de longs mois, à me mettre à leur service ».
J’ai l’impression que ces personnages, vous les avez écoutés dans le cadre de la nouvelle comme dans celui du roman. J’ai hésité à évoquer ici « Concerto à la mémoire d’un ange » ou « La rêveuse d’Ostende ». Ces deux textes sont beaux et très forts. J’ai choisi cette dernière nouvelle, car c’est la plus poétique, car le pouvoir de l’imagination est à son comble, c’est aussi la plus mélancolique, car le narrateur est lui-même un personnage attachant. Réfugié à Ostende, ville endormie face à la mer du nord, pour guérir d'une rupture sentimentale, il est fasciné par sa logeuse, la solitaire Emma Van A., infirme, qui lui raconte l'étrange histoire de sa vie, celle d’un amour aussi passionné que mystérieux. Tout au long de la nouvelle, le lecteur se demande –comme le narrateur- si ce personnage féminin unique n’est pas une mystificatrice et il ne peut pas trancher. La sympathie complexe qui se noue entre le narrateur et cette femme étrange est un des grands charmes de cette histoire mélancolique qui nous dit, que quelle que soit la vérité finale, celle des faits qui sera dévoilée, le rêve est la véritable trame qui constitue l'étoffe de nos jours.
J’évoquerai ensuite l’audacieux roman La part de l’autre, mais est-ce encore un roman ? C’est un livre au carrefour de la biographie (celle d’Hitler), de l’essai sur l’Histoire, de l’uchronie. Sans doute le projet littéraire apparent consiste-t-il à instaurer au sein même de la narration un parallèle entre écriture biographique et écriture uchronique (L'uchronie étant un sous-genre de la Science-fiction) qui vous permet d’introduire une réflexion singulière sur le sens de l'histoire. Mais pour moi, l’essentiel du livre est à chercher ailleurs, en relation avec L’Evangile selon Pilate. Vous dites vous-même ce qui vous a le plus poussé à écrire ce livre dans le Journal de la part de l’autre :
« La décision est prise : après Jésus. Hitler. L’ombre succède à la lumière. Pour avoir étudié la tentation de l’amour dans l’EP, je me dois d’approcher désormais la tentation du mal. Puisque c’est dans l’humain et non en dehors de l’humain qu’ont lieu et Jésus et Hitler, mon humanisme n’existera qu’au prix de cette double poursuite »
Il y a un défi considérable au départ de ce livre, une prise de risque aussi, de ce livre qui va prendre une ampleur que vous ne soupçonniez pas puisque vous allez faire vivre des époques, des lieux et pas seulement des idées. Je l’ai lu comme un roman humaniste pas comme un roman à thèse. Vous avez inventé de très beaux personnages féminins, qui sont la lumière de ce roman. Comme dans vos plus grands textes, une touche de mélancolie entoure ces histoires qui se croisent. Vous nous jetez dans des émotions pleines de pensées car ce qui est en cause comme dans l’Evangile c’est l’humain et ses frontières, toutes ces frontières, celles qui vont vers la lumière, celles qui vont vers les ténèbres, c’est le mystère de l’humain, c’est la conversion de ce vide dont je parlais plus haut au cœur de l’homme vers le bien ou la barbarie. Votre double portrait antagoniste (avec une progression remarquable dans l’antagonisme au fil du roman) a une visée éthique. Il vous permet de repérer un seuil qui définit l’humain et une zone frontière de basculement. Il vous permet de nous faire réfléchir de quelles ambiguïtés relève cet espace de l’opposition entre humain et inhumain, de réfléchir à la place de la problématique de soi ou l’autre et de "soi et de l'autre" soulevée par le monstrueux. Le monstre est-il en nous-mêmes ou est-il radicalement autre ? Le monstre n’est-ce pas aussi celui qui, parce qu’il est incapable de s’ouvrir aux autres, à l’altérité, se débarrasse de l’homme en lui, défait l’humain qui est en lui, celui qui se ferme radicalement, définitivement ? Hitler se ferme tandis qu’Adolf H. s’ouvre ; Hitler instrumentalise les autres tandis qu’Adolf H. leur laisse prendre de plus en plus de place dans sa vie ; Hitler s’enivre de certitudes tandis qu’Adolf H. souffre de doutes. L’imaginaire poétique qui fait vivre ces idées nous invite aussi à nous interroger sur la haine de la nature qui intervient lorsque l’humain va se transformer en monstre. Comme la réflexion sur l’histoire sous-tend ce questionnement éthique vous mettez en lumière le caractère contagieux du monstrueux psychique qui peut susciter un vent de folie, vous suggérez comment la barbarie est toujours liée à une puissance aveugle, vous nous faites sentir de manière sensible, imagée, que l’inhumain peut resurgir à tout moment lorsque le pouvoir de l'être humain dépasse son savoir. L'homme qui veut se suffire à lui-même (le péché d'orgueil), se condamne à avoir un horizon qui se restreint et se resserre de plus en plus.
Audacieux vraiment, vos deux livres osent opérer une humanisation du bien et du mal dans les personnages de Jésus et d'Hitler, car l’homme est capable du meilleur comme du pire. En ce sens, L'Evangile selon Pilate et
J’ai déjà beaucoup évoqué L’Evangile selon Pilate. Je n’en dirai que quelques mots. Il me semble la clé de voûte de votre œuvre diverse, non seulement parce que la dimension spirituelle de l’œuvre qui pouvait être latente ou inconsciente avant ou après ce texte est très grande mais parce qu’il porte très haut, dans une écriture à la fois simple, dépouillée et dense – l’écriture poétique n’a pas besoin d’être ornée pour nous toucher -, cette esthétique de l’invisible dont je parlais plus haut.
Vous insistez sur l'humanité de Jésus dans la première partie du livre en particulier. Nous pouvons aussi bien comprendre Jésus par l'homme qu'il est ou par le Dieu qu'il est aussi et qu’il trouve peu à peu en lui. Même à la fin, il ne sait pas s'il est vraiment fils de Dieu, seule
Je n’en dirai pas plus aujourd’hui sur une œuvre foisonnante qui s’ouvre également sur le cinéma, une œuvre de notre temps, mais qui ne cherche pas à être à la mode, nourrie par une pensée imaginative très féconde, qui se développe parfois contre l’esprit du temps, en particulier lorsqu’elle se tourne vers l’invisible, une œuvre parfois inclassable génériquement, qui mérite amplement qu’on lui consacre, l’an prochain, un colloque dont le but sera d’en faire connaitre la diversité et l’originalité – bien au-delà de la « célébrité qui est la vôtre- car je suis persuadé que la célébrité d’un écrivain –aussi enviable soit-elle- peut quelquefois, parce qu’elle véhicule forcément des clichés, cacher la réalité profonde de son œuvre.